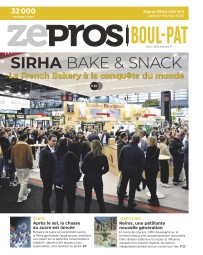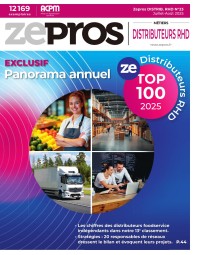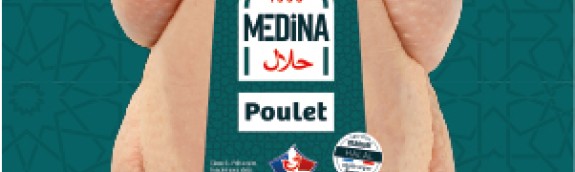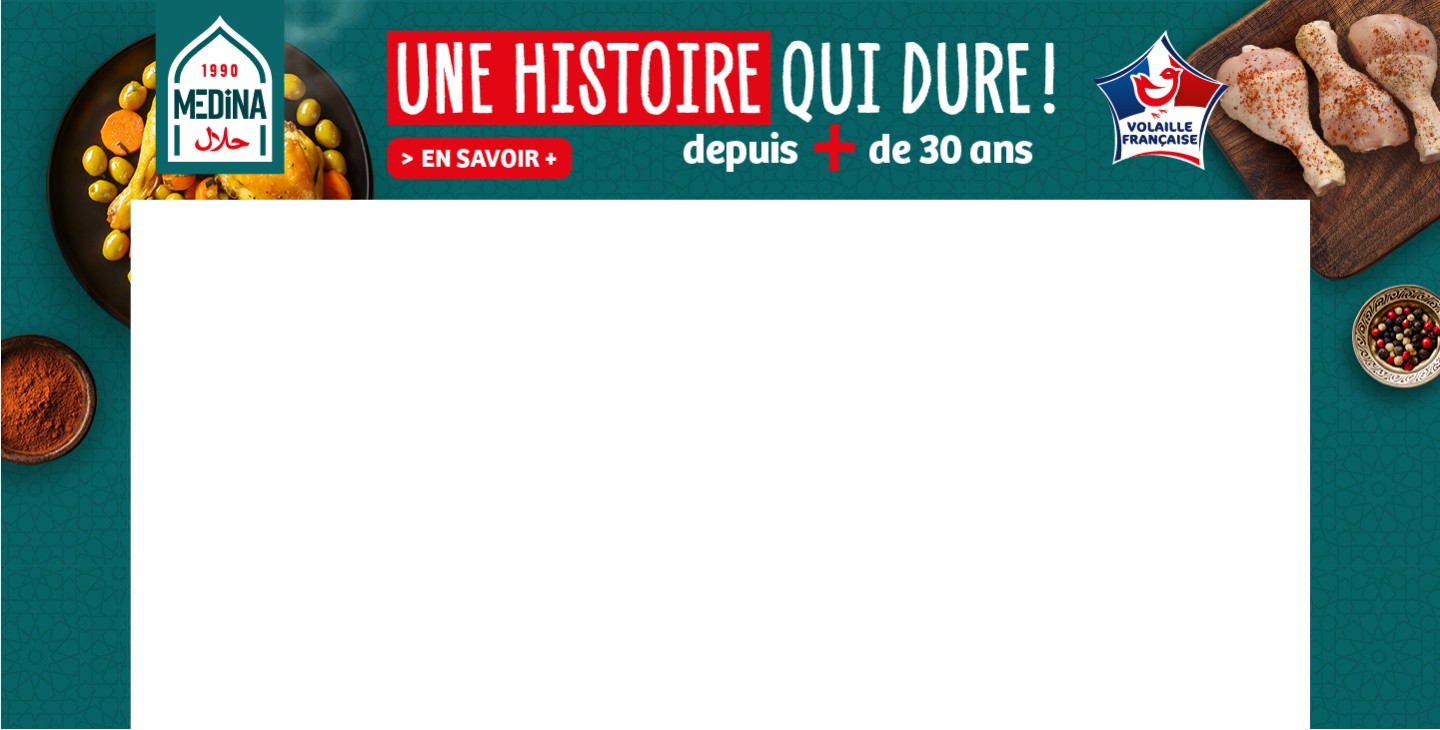
L'ajustement carbone aux frontières, un nouveau danger pour la filière céréalière

Trois ans de revenus négatifs... et une nouvelle taxe venant potentiellement alourdir leurs coûts de production. Au 1er janvier 2026, la mise en place du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) voulue par la Commission Européenne placera les producteurs de blé dans une situation particulièrement critique... aux conséquences lourdes pour l'ensemble de la filière.
Les engrais sont devenus, au fil des années, un coût particulièrement pesant pour les producteurs de céréales. Selon l'Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB), ils représentaient 21 % des charges à l'hectare en 2023, et même 65% des charges variables sur la période 2019-2023. Le millefeuille de réglementation décidé à l'échelle de l'Europe, entre droits de douane et taxes anti-dumping, a activement participé à cette situation. Le conflit ukrainien a accéléré l'inflation de façon notable, de par la forte dépendance aux produits russes. En effet, la Russie était en 2021 le premier exportateur d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés au monde.
La MACF, un frein majeur aux importations
Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF), également connu sous l’acronyme anglais CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), est un dispositif imaginé à l'échelon européen. Appelé à entrer en vigueur au 1er janvier 2026, il vise à imposer aux produits importés sur le territoire de l'Union un cadre similaire à ceux fabriqués localement. En clair, la taxation devrait permettre d'instaurer une tarification du carbone équivalente, et donc restreindre drastiquement la compétitivité de ces importations. Les engrais sont particulièrement concernés par une telle mesure : depuis début octobre, les importateurs de cette catégorie de produit ont à leur disposition un outil permettant d'estimer le surcoût engendré par la nouvelle taxation. Parmi les exemples cités par l'AGPB, deux composants essentiels des engrais laissent entrevoir l'impact économique du dispositif. Un bateau chargé de 20 000 tonnes d'urée se verrait taxé à hauteur de 2,8 millions d’euros (soit 144€ la tonne), quand un chargement de 40 000 tonnes de solution azotée subirait un surcoût de 4,8 millions d’euros (121€ la tonne).
Des risques réels pour la concurrence et la pérennité de la filière
Pour Cédric Benoist, secrétaire général adjoint de l'AGPB et président du groupe de travail Céréales COPA COGECA, l'histoire est déjà écrite. Du fait des marges limitées engrangées par les opérateurs, "pas un seul ne prendra le risque d’importer" du fait de cette nouvelle taxe. Ainsi, les céréaliers français n'auraient plus que des engrais européens à leur disposition, le flux de produits d'une provenance extérieure à l'Union s'étant tari. Privés de concurrence, les fournisseurs pourraient alors faire le choix d'augmenter drastiquement leurs tarifs... asphyxiant par la même occasion une filière déjà exsangue. Du fait de ces charges intenables, les producteurs de blé pourraient alors faire le choix de se détourner durablement de cette activité, préférant la jachère à la conduite d'une culture largement déficitaire. Même si le territoire français continue d'exporter des grains, cela pourrait remettre en question la souveraineté alimentaire du pays à moyen et long terme.